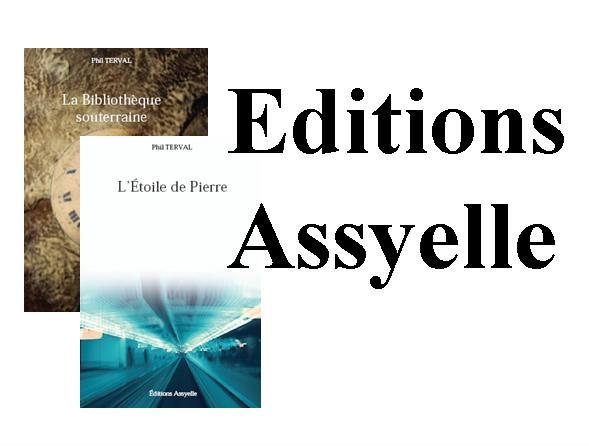 |
Supporter la Terre
Une suicidée, une
espèce d'enquêteur, un suicideur,
|
|
|
CATALOGUE |
Mais réfléchissez, réfléchissez, vous êtes sur terre, c’est sans remède ! Samuel Beckett
PrologueC’était sur une petite route de Bretagne qui suit les collines et les landes, aux alentours de quatre heures du matin, à l’heure où l’on écarquille les yeux pour ne pas tomber dans le sommeil après avoir roulé toute la nuit. Derrière, le soleil à peine donnait quelques lueurs à la nuit et il faisait froid. Devant, il y avait la mer et il ne restait que quelques kilomètres pour atteindre la maison sur la côte et s’allonger enfin. Soudain plein de lapins filèrent devant les phares de tous les côtés comme des pétards, et la Range Rover en percuta un. Il ne roulait pas vite ; il s’arrêta vingt mètres plus loin sur le bas-côté. Le choc avait sonné comme si quelque chose avait éclaté. Il ouvrit la portière, descendit de voiture, resta là debout un instant. Il n’y avait personne nulle part, pas un mouvement, des étoiles tout autour. Là-bas vers l’est le bleu de la nuit virait au bleu clair, au vert, au rose. Et tout là-bas sur l’ouest encore dans la nuit s’étalait la mer dont on pouvait croire entendre le bruit, mais les seuls sons étaient ceux du moteur diesel, bas et calmes. Il était en chemise, il faisait froid mais tout inspirait la douceur, le repos, la quiétude. Il inspecta les phares, le pare-chocs : il n’y avait rien, apparemment. Quand il remit la main sur la poignée de la portière, il distingua quelque chose, vaguement éclairée par les lumières de la voiture, qui bougeait sur le bord de la route là-bas. Le lapin, plein de sursauts convulsifs. — Oui ben je pouvais rien faire. Il se réinstalla au volant, souffla, bailla, introduisit un CD bien rock dans le lecteur, attacha sa ceinture : ça faisait une pause, cette histoire de lapin. Mais en regardant dans le rétroviseur pour démarrer, il vit encore ce truc qui sautait là-bas derrière, comme une ombre de pantin dans le rouge des feux arrière. Sans réfléchir, comme on se lève pour mettre en veilleuse un appareil mal éteint qui continue de clignoter, il détacha sa ceinture, ouvrit la portière et s’avança vers l’animal qui tournait autour de lui-même dans les premières herbes au bord de la route. Il l’éclaira avec son portable : c’était un tout petit lapin de garenne, une toute petite peluche de lapin. Les pattes arrière étaient enfoncées, le bas du dos était tordu, les poils étaient mouillés de sang. Il ne pouvait pas s’en tirer, évidemment. Il avait une petite bouille toute ronde de Jeannot Lapin, ses pattes avant essayaient d’agripper l’air, et ses yeux grands ouverts découvraient la terreur. — Attends, je vais pas te laisser comme ça. Quand il était petit, dans cette Bretagne, il avait accompagné un jour sa grand-mère chez le paysan qui lui vendait ses lapins ; il avait vu le bonhomme saisir une bête dans le clapier, par les oreilles, la sortir tranquillement – elle se débattait à peine – et lui donner un coup sec par derrière du tranchant de la main. Le lapin ne bougeait plus. C’était impressionnant, net, facile. — Bon… comment il fait, le paysan ? Il se baissa, essaya d’attraper l’animal mais l’animal blessé se débattait et sautait dans tous les sens — il y a beaucoup d’énergie et de force dans une masse de chair vivante et chaude. Il se retrouva à quatre pattes dans la rosée. — Allez bouge pas, va. Le ciel tout lentement s’éclaircissait ; pas de voiture, personne nulle part ; pas de bruit autre que le son du moteur là-bas. Enfin il réussit à immobiliser la petite bête en la saisissant par la peau du cou puis il attrapa ses oreilles de la main gauche. Il la souleva, gigotante, essaya d’évaluer le bon endroit sous la tête, étira sa main droite à la façon d’un karatéka, simula trois fois le geste dans le vide, et donna un grand coup derrière les oreilles, comme le paysan de son enfance. Sa main gauche fut surprise par le choc et les oreilles glissèrent. Le lapin tomba en couinant, — Merde… et tenta de fuir dans les herbes mouillées en traînant son arrière-train, mais les pattes arrière écrasées étaient trop lourdes et trop ensanglantées. Ses yeux globuleux regardaient l’homme d’un regard pitoyable et terrifié. L’homme, avec son cœur accéléré, regardait le corps de l’animal qui convulsait au rythme d’un cœur éperdu qu’on entendait presque, les respirations mêlées accélérées, dans l’aube qui se levait en rouge à l’est, complètement silencieuse. — N’aie pas peur… allez, il faut arrêter de souffrir… je t’aide, c’est tout… c’est pas de ma faute… je t’aide je t’aide. Il se leva, chercha autour de lui ; on distinguait du bois mort dans les herbes. Il trouva un bâton solide qu’il prit à pleine main, qu’il serra fort pour l’assurer dans sa main droite. — N’aie pas peur… je vais t’aider… c’est pas grave. Il saisit les oreilles sans hésiter cette fois, inspira fort, souleva le lapin et frappa. Il lâcha ensuite la bête et laissa tomber le bâton. Des phares approchèrent et une voiture passa alors. Il se tint droit comme s’il pissait en sifflotant. Mais à ses pieds le lapin tournait sur lui-même, encore plus fort, les yeux encore plus hors d’eux-mêmes. — Non non, mais qu’est-ce que tu fais, il faut mourir maintenant, c’est pas la peine de souffrir… arrête arrête ! Alors il le reprit et frappa encore mais dans sa main moite les oreilles glissaient et le corps dansait et les yeux du lapin ne se fermaient pas. — Bouge pas bouge pas…! Arrête de bouger merde ! La rage et les larmes montèrent dans les yeux de l’homme au rythme des gros coups sur le petit lapin. — T’avais qu’à pas te foutre dans mes roues, merde ! Fous-moi la paix ! Je t’aide ! Meurs, bordel ! Il frappa encore et encore, la main gauche écrasant les oreilles, jusqu’à entendre le bruit du sang sur le bâton et alors enfin ça ne bougea plus ; il jeta tout, le bâton et la masse informe du lapin, dans les herbes. Il y eut encore un soubresaut. — … Fais chier ! … merde ! ... salaud ! Il retourna vers sa voiture, ouvrit la portière, s’assit. Il posa ses mains douloureuses, encore tétanisées, poisseuses, sur le volant, posa son front humide comme un fiévreux sur ses mains, ferma ses yeux piquants et, bouche ouverte, s’efforça de ralentir sa respiration et d’avaler les sanglots amers. Le soleil allait apparaître derrière, une brume naviguait lentement sur la lande, tout au loin devant on devinait la mer, avec un navire peut-être qui naviguait lentement au loin, et une première alouette s’éleva haut en hurlant au monde entier ce qui s’était passé.
La Mimette et son JeannotLa vieille femme regarde son petit-fils. Elle pense que le petit Jeannot est devenu en un rien de temps un homme dans le monde, avec des traits d’usure sur la peau, des rides et des marques qui indiquent une vie à soi, une pensée et des inquiétudes qui se sont affermies, des postures de grande personne qui ne se réfugie plus dans les jupes de sa mamie quand les copains ne veulent pas de lui pour jouer. Le petit Jeannot s’appelle Jean-Charles, Jean-Charles Letailleur. C’est un garçon de quarante ans. Il a un visage rond, des cheveux noirs coupés en brosse, des lunettes rondes cerclées de noir qui lui donnent un air dans le coup, vaguement intellectuel ; ses yeux sombres sont les mêmes que ceux de sa grand-mère ; son corps est assez petit, rond et bronzé, son torse tend un polo Lacoste vert-Neuilly. Lui, il regarde ses chaussettes rayées. Dans les rayures de ses chaussettes de petit garçon, il cherche l’image de sa grand-mère, mamie Guillemette, qu’il a toujours appelée Mamie-Mimette, qui lui a servi de maman, de doudou, de nounou, de mamie, d’être aimé, et qui est en train de disparaître, absorbée par la carapace cireuse que lui fabrique un joli petit cancer débarqué dans son vieil utérus, qui prend ses aises et se généralise en grignotant tout ce qu’il trouve autour. Il n’ose d’abord pas regarder vraiment le visage boursouflé : il ne reste que les yeux noirs profonds et rieurs d’une grand-mère aimante et complice. La peau autour est jaune, gonflée, déformée, le visage est bousillé, comme cogné à coups de poing du dedans. Les rides, qui s’étiraient à l’arrière des yeux quand on riait ensemble sur le dos des abrutis et faisaient du visage de mamie une jolie petite pomme fripée et malicieuse, sont comblées par la cortisone ; le crâne sans cheveux laisse à nu les pauvres bosses, des squames et des écorchures d’une espèce d’eczéma, des points et des trous dans le cuir tout mal fichu. Autrefois une chevelure blanche coulait en élégance : c’était une élégante, mamie, une petite dame bourgeoise très distinguée qui parlait avec distinction d’une bouche douce et d’une voix de jeune fille ; les lèvres qui racontaient les histoires sont désormais deux traits secs qui réclament à boire. — Non, Mimette, le médecin a dit qu’il ne faut pas boire, tu le sais bien. La vieille femme sur son lit d’hôpital fait un signe de la main qui peut vouloir dire que le médecin peut bien aller se faire admirer ailleurs. Elle se redresse sur ses petits bouts d’os de bras et chuchote : — Jeannot, donne-moi de l’eau et approche-toi… Jeannot est le Directeur des Ressources Humaines de la clinique dont il est actionnaire par ailleurs et dont son père, grand actionnaire aussi, est le chef du service chirurgie. Il revient tout juste d’un séjour aux États-Unis où il a étudié les modes de management du personnel dans les centres hospitaliers américains. La grand-mère a profité de son absence pour laisser croître et multiplier son petit crabe et voilà, à son retour, il ne reconnaît plus en cette momie jaunasse qui ressemble à la mort la Mimette qui lui soufflait la vie dans les bronches depuis le début de l’existence. Elle est installée dans une des meilleures chambres de la clinique, une de celles réservées aux émirs du Golfe qui choisissent la prostatectomie française, la réputation internationale de l’établissement et la proximité de la place Vendôme. La médecine lui accorde quelques mois de vie, un an peut-être, peut-être un peu plus : à son âge, l’évolution de la maladie est plus lente. La chimiothérapie lui donne ce répit, à coups de batailles rangées insupportables, et sans espoir au bout du compte. Il se tourne vers la vieille dame qui sourit comme elle peut, un sourire à faire pleurnicher un grand garçon, s’approche tout contre ses lèvres. — De l’eau d’abord… Il rappelle l’interdiction mais remplit tout de même un verre et lui fait boire comme à un bébé, « C’est bon » dit-elle en fermant les yeux. Il se rappelle les sirops d’orgeat des mercredis d’été apportés en bouteille de verre à la cascade des Buttes-Chaumont et plus confusément les biberons donnés par cette femme qui l’a élevé. Il pose le verre et se penche sur le souffle de Mimette. — J’en ai assez mon petit Jeannot. Je veux partir. — Bien sûr tu vas rentrer, Mimette, je te promets. Mais il faut que tu reprennes un peu de force, répond le petit Jeannot qui a l’intuition simultanément que ce n’est pas la bonne réponse. La malade ferme les yeux et ses vieilles lèvres sourient : — Ne fais pas l’imbécile… Tout a été bien jusqu’à maintenant, et maintenant j’en ai assez. — Non non voyons arrête, ne dis pas ça, tu as encore plein de temps devant toi… — Ça fait souffrir tu sais. Terriblement. J’en ai assez. — Non non ma Mimette, tu vas rentrer chez toi, tu vas guérir de cette saleté. — Je ne vais pas guérir. Je veux partir. — J’ai besoin de toi encore. — Je ne peux plus rien faire pour toi. Je veux partir. — Je veux pas que tu t’en ailles. — J’en ai assez. Je veux partir. Tout ça se chuchote puis la vieille femme gémit comme un petit chien, hallucinée et endolorie par les combats perdus de la chimie et le brouillard de la morphine. Elle répète la même chose, en s’épuisant de lassitude. Il proteste, ne veut pas laisser filer l’évidence, celle des mères ou des grands-mères nourricières qui se débinent avant les enfants. Jusqu’alors, il croyait qu’elle était éternelle, sa Mimette. Et aujourd’hui elle lui annonce qu’elle est une vulgaire mortelle de rien du tout, qui se fait choper par le premier cancer venu, plaquer au sol comme un rien, et qui va mourir. Il le sait pourtant : les grands-mères meurent. Croire qu’elles sont éternelles c’est de la poésie de petit enfant, de l’imbécillité heureuse de môme. Le petit môme Jeannot voit la mort de Mimette et elle n’est pas semblable aux morts qu’il côtoie, celles des autres dont on se fout comme on se fout de la grippe du voisin, qui ressemblent aux histoires de cinéma, des morts qui vous font tressaillir dans votre fauteuil par sympathie animale, rien de plus. La mort de Mamie-Mimette, la vraie maman du petit enfant Jean-Charles, est une mort qui existe pour de vrai, une mort éternelle qui laisse éperdu dans l’univers, qui attend sur le lit d’hôpital en puant et qui se rapproche. La mère biologique de Jean-Charles Letailleur, biologique et virtuelle à la fois, s’appelle Claudine. Elle est femme d’affaires, PDG d’une grande enseigne de vente par correspondance dont la santé est extrêmement arrogante, et pointeuse dans quelques conseils d’administration. Elle a accouché très jeune et avec dégoût d’un enfant conçu dans l’hébétude d’une fête d’étudiants, en concevant le jour même l’idée de se faire ligaturer les trompes pour ne pas avoir d’entraves gluantes à son ascension dans le monde du Monopoly international. Sortant de la maternité à peine sortie d’HEC, elle prit rendez-vous avec sa belle-mère pour fixer les modalités d’une garde, provisoire dit-elle, le temps de terminer ses stages et de trouver une bonne place. La belle-mère, veuve encore assez jeune et en mal d’enfant – elle avait eu deux fils, l’aîné médecin généraliste et sénateur ronronnant de la majorité dans le Haut-Rhin, le cadet chirurgien assez talentueux, les deux élevés à la grande-bourgeoise par une nourrice bretonne –, avait rapidement proposé ses services, d’autant que, la belle-fille ayant à plusieurs reprises laissé entendre en râlant sur son gros ventre et ses nausées au cours de la grossesse que le géniteur lui avait quand même forcé la main et pas seulement la main, elle se sentait en quelque sorte maternellement redevable. En fait de garde provisoire, ce fut un trois-six-neuf à tacite reconduction. Claudine méprise les fonctionnaires les syndicalistes les clochards les travailleurs sociaux et les intermittents du spectacle, croit qu’on mérite sa vie et que la véritable justice est celle qu’instaurent naturellement les rapports de force entre les hommes, que ces rapports dépendent du talent naturel et de la force de chacun, qu’ils s’illustrent en dizaines de milliers d’euros mensuels, et que le vrai féminisme règnera sur terre quand les femmes auront des couilles. Le père biologique s’appelle Henri. Poussé par la loi familiale, il a fait médecine à contrecœur, très peu enclin à écouter les plaintes et les petits enfers des autres, et s’est rattrapé en persistant dans ce qui l’intéressait vraiment au fond, le bricolage, – il aurait aimé être plombier, le petit Henri, ou mécano – et il est devenu un chirurgien réputé pour les opérations impossibles et sa capacité à rester huit heures parfois sans broncher autour d’un ventre ouvert plein de problèmes de tuyauteries qui fuient. De piston familial en piston politique, il est devenu chef de service à la clinique dont il est actionnaire pour moitié et co-directeur, associé à un cousin aussi bien né et pistonné. Henri est un type très intéressant bistouri à la main ; beaucoup moins par ailleurs et Jean-Charles considère son père comme un homme pusillanime et sans épaisseur. Le couple fonctionne tout à fait bien : un dérapage de jeunesse – Jeannot – et une maîtrise parfaite des pulsions ensuite ; les noces durent sans passion aucune, chacun vit une passionnante vie de privilèges et d’égoïsme, d’argent, de relations mondaines. Le sexe intervient de temps en temps, rarement ensemble, – si, certain soir parfois vers minuit après un cocktail commun où tout se débonde – en général avec des partenaires de même tonneau, d’autres solitaires sans mélancolie. Les relations, la caste, les actes notariés tiennent lieu de ciment et l’amour l’amour l’amour je ne sais pas exactement de quoi vous parlez. Le petit Jeannot comprend ce que réclame sa grand-mère. D’abord il a envie de fuir, retourner là-bas aux États-Unis, faire comme s’il n’était jamais venu dans cette chambre et attendre comme il l’a toujours fait que les sales choses se dépatouillent toutes seules, puis peu à peu il se fait à l’idée, une idée d’abord terrifiante, puis concevable, et en arrive à considérer enfin qu’il n’y a rien de plus naturel que de zigouiller mère-grand.
***
Il n’en parlera pas à son père : il sait que celui-ci dira qu’il est extrêmement rare qu’une demande d’euthanasie prononcée par un patient aboutisse car en général elle correspond à un état de faiblesse et de souffrance. Or faiblesse et souffrance ne sont ni permanents ni continus, et dès qu’on sort ne serait-ce qu’un peu de cet état – à la grâce de la morphine par exemple –, le corps réclame la vie et on se rétracte. Bref, ce n’est pas sérieux. Puis son père considère qu’il n’est pas catholique de décider à la place de Dieu. Ensuite, catholique ou pas, Jeannot sait son père incapable d’endosser l’idée même de pousser qui que ce soit dans la tombe, même sans le faire exprès, avec les risques de complications juridiques, de procès, de publicité que cela comporte (il est multi-assuré pour chacun de ses actes chirurgicaux) et éventuellement de remords, et encore moins sa propre mère mon Dieu mon Dieu. Enfin, son père, il le méprise définitivement. Mimette a raconté à Jeannot le jour où, les deux belles-filles et les deux fils autour de son lit la croyant endormie, l’héritage s’est discuté à voix basse : la maison de la villa des Boers, la propriété du Val-André, etc. On suggéra telle transaction pour ne pas donner l’avantage au fisc, telle donation du vivant de mémé pour préserver les acquis, on s’interrogea à voix encore plus basse sur les idées que la vieille tête de malade pouvait avoir – l’a-t-elle encore d’ailleurs, toute sa tête ? – des idées qu’on espérait équitables. Elle reçut des visites d’avocats noirs et marron comme des croque-morts, les yeux pétillants et les mains frétillantes. La vieille dame comprit que tontons et tatas se donnaient quelques semaines pour tout régler sur son vieux dos et elle décida de leur faire une surprise en claquant entre leurs doigts crochus juste un peu avant. Jeannot regarde encore ses chaussettes rayées, trouve encore dégueulasse mais magnifique, magnifique mais dégueulasse, de décider de la mort de sa Mamie-Mimette, qu’il considère comme une sorte de déesse dont il a l’intuition qu’elle va lui révéler, en l’élisant, la valeur de sa propre vie et l’insignifiance de celle du commun des pauvres et imbéciles mortels, comprend vaguement que lui-même est sur le point d’y entrer vraiment, dans la vie, comme un roi de la vie et de la mort, et croit entendre dans un coin de son crâne d’enfant le cri des mouettes au-dessus de la grande maison de famille de Bretagne, sentir l’odeur de la dorade grillée et il se découvre tout à coup tout petit, seul et malheureux, seul malheureux au monde avec une envie de pleurer comme un petit mioche gâté à la fin des vacances. Il l’a bien sûr toujours aimée, sa grand-mère, mais jamais il n’a eu besoin de prouver qu’il tenait fondamentalement à elle. D’ailleurs jusqu’à ce jour il a bien été incapable de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, encore moins de donner. Il doit sa position de grand garçon riche à quelques diplômes obtenus en trichant sur les bords, et à quelques fameux pistons familiaux. Il n’a jamais dit merci pour ces trafics ordinaires et peut-être à cause de cela il dédaigne tranquillement les autres, tous, dans un mépris qui va croissant, de ceux qui abusent à ceux qui n’osent pas et jusqu’aux crétins qui se laissent abuser. Comme tout le monde il a parfois imaginé la mort de sa grand-mère. Il se voit en tête de cortège au cimetière, lunettes de soleil et costard noir, regard sur le chemin, il se voit ne pouvant aller au bout de son discours à cause de sanglots qui piquent la gorge, il se voit au centre d’une histoire grave, lui le préféré de mamie, au cœur de la souffrance – une jolie douleur en beau costume –, personnage plein d’importance ce jour de cimetière qu’on salue plus bas que tous les autres, plus bas même que les propres fils de la défunte, un authentique personnage de tragédie enfin. Mais aujourd’hui Mamie-Mimette lui demande de la tuer, alors ce n’est plus pareil. Au cimetière, ce sera lui le roi du monde des morts et des pleurnicheurs. Personne ne saura rien et lui saura tout. Les larmes des crocodiles tomberont ploc ploc sur la terre et c’est lui qui aura fait cette loi. Voilà quelque chose ! Pour une fois ! Tragique, grand, magnifique, sublime ! De l’amour, ma Mimette ! C’est beau mais ça fout la trouille au petit garçon. Alors, quand le petit Jeannot a mâché avalé, chialé-comme-un-môme dégluti et digéré la possibilité de la mort, de la fin de l’éternité, du geste qui tue, du pouvoir de nom de Dieu, il se prépare avec sa mère-grand qu’il appelle Mimette. Comment faire ? Elle dit, les yeux fermés, tranquillement : — Je sais parfaitement ce que je dis, je suis tout à fait consciente. Tu ne peux pas savoir comme je souffre. Avec la morphine c’est supportable, mais parfois même avec la morphine c’est insupportable et ça va empirer, ça ne peut pas aller autrement, ça n’ira jamais mieux et c’est infernal. S’il te plait, aime-moi vraiment. Sur le même ton elle lui disait autrefois que l’amour est comme la drogue, qui rend bêtement heureux et stupidement dépendant, qui ne peut aller qu’empirant et que ça ne vaut pas la peine de pleurnicher comme une madeleine, pauvre Jeannot d’artichaut, parce qu’une minette même pas ton genre te balade dans son bateau. L’amour comme une morphine. — Je comprends, Mimette. La vie n’est pas éternelle et l’éternité est paisible. La vie des hommes ne vaut pas la vie de sa grand-mère qu’il va tuer comme on tue affectueusement son vieux chien qui n’en peut plus de traîner ses vieilles pattes douloureuses. Il comprend qu’en l’embarquant ainsi dans sa mort, sa grand-mère lui donne aussi un vrai gage d’amour, un viatique pour tous les temps qui lui restent, une union religieuse qui fait la nique à la terre entière. — Comment on va faire, Mimette ? La vieille femme est tout heureuse derrière son masque de cire. On dirait une vieille SDF qui aurait pris sa dérouillée pour une bouteille, pleine de coups sur le visage, un œil est poché, le nez est enflé, les joues sont gonflées, c’est jaune, rouge, violet, et qui se marrerait quand même de sa bouche sans dents de la bonne peignée que l’autre a prise. Elle cherche ses mots et Jeannot se surprend à dire sans frémir : — Chlorure de potassium… — Non non… Il réfléchit : une infirmière passe tous les quarts d’heure quand elle est seule et son père Henri vérifie les perfusions, quand il ne les pose pas lui-même. Mimette n’est pas encore en phase terminale et médicalement parlant elle ne doit pas encore mourir, les suites de sa longue et douloureuse maladie comme on dit ne sont pas encore fatales. Alors le chlorure de potassium, ça ne va pas. — Approche-toi… Le petit-fils s’assied sur le lit et se penche tout contre la vieille dame si distinguée qui sent un mélange de lessive, d’urine, d’antiseptique, de maladie. Elle ouvre à peine les lèvres. — J’ai un peu peur tu vois… il faut que tu me portes jusque là-bas… quand je serai mal ça ira… ça sera plus facile tu comprends… quand j’aurai trop mal tu m’emporteras… pas besoin de rien… dans tes bras tu comprends… quand j’aurai très mal… tu me serreras et ça ira.
|