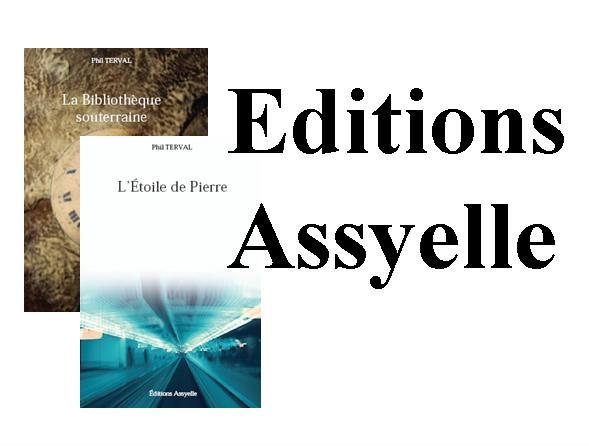|
|
Et les mouettes… étaient indifférentes |
|
|
|
|
Introduction Mon ami, tu m’as vraiment désarçonnée avec ta question : « Si
malheureuse que ça ? » Elle m’a fait l’effet d’un choc, et je suis restée sans
réponse. Tu ne l’avais pas posée en inquisiteur et sans doute même pas
avec beaucoup de curiosité. Nous ne nous connaissions guère et seulement
depuis très peu de temps. Au moment où nous parlions, où nous nous racontions
un peu, je venais de te dire combien mes dernières années en solitaire
étaient les plus heureuses de ma vie. Cette constatation énoncée simplement,
naturellement, t’avait vraiment surpris. De te l’avoir spontanément dit
m’avait étonnée moi-même. Je ne m’étais jamais posé directement la question comme tu
venais de le faire. D’ailleurs, je me demande si elle était nécessaire. Mais,
nécessaire ou pas, à partir de ce moment précis, ma conscience fut prise d’un
grand besoin de compréhension et d’explication. Sans que tu le réalises –
comment l’aurais-tu pu ? – tu m’avais envoyée en introspection tout au
fond de moi-même. Trouver une réponse me paraissait tout à coup essentiel. Peut-être, sans m’en rendre compte, étais-je arrivée au temps
du bilan ? Peut-être qu’une longue vie derrière soi est favorable à un
regard d’ensemble. Peut-être ai-je ressenti alors une curiosité par rapport à
moi-même... comme s’il s’agissait de quelqu’un d’autre... ? Mais peu
importait la raison, je me suis mise à reconsidérer ma vie avec une
objectivité que seul rendait possible le passage des années. Toutefois, avant de revisiter ma vie pour y chercher une
réponse qui la définirait en termes de bonheur ou de malheur, je peux déjà
affirmer qu’il y a toujours eu pour moi de grands moments de bonheur, de
joies intenses, surgis comme des lames de fond, submergeant tout. Comme par
un effet purificateur. Il suffit souvent que je descende sur notre plage, que mes
orteils nus laissent passer entre eux le sable blanc, doux et si fin ; il
suffit que, tournée vers le point d’où le soleil va émerger juste devant moi,
je ferme les yeux, que j’aspire voluptueusement le vent salé du large, pour
sentir monter en moi des vagues de bonheur pur. J’entends alors simultanément
le bruit sourd et mélancolique des récifs au loin et, tout près, le clapotis
léger des vaguelettes qui viennent mourir sur la plage. Seul, un pêcheur, faisant silencieusement glisser sa pirogue
avec sa perche, atteste d’une autre présence. Nous sommes, lui et moi,
parallèlement, parfaitement en osmose avec cette nature dont la perpétuelle
musique de fond est tout de même un peu triste. Et je me demande s’il y a toujours un fond de tristesse dans
le bonheur. Ou si l’on trouve des traces de bonheur mêlées à la
tristesse ? Ma vie, je le sais bien, est un entremêlement de périodes
malheureuses, de mélancolies inexpliquées, de moments de tristesse, de
découragements profonds, mais aussi de temps d’émerveillement, de
satisfactions profondes, de joies, de bonheurs, d’espérance et même
d’euphorie. Dans ces conditions, comment répondre à ta question-remarque :
« Si malheureuse que ça ? » Je l’ai été sans doute assez par
moments pour justifier ce mur protecteur érigé comme une armure intérieure,
pour protéger mes vulnérabilités exagérément sensibles. Mais, quoi qu’il en
soit, mon indéfectible joie de vivre refait surface. C’est une disposition de
l’âme sur laquelle je sais pouvoir absolument compter. La vie, notre vie, j’ai toujours eu tendance à la comparer à
un arbre qui grandit et se développe à partir de ses racines. Un arbre ne
peut puiser sa sève que dans le sol même où il est enraciné. Si j’utilise
cette comparaison en ce qui me concerne, je suis consciente que le pivot de
ma vie d’adulte n’a pas plongé dans le sol qui lui aurait le mieux convenu. Je
me suis sentie si souvent en décalage avec mon entourage direct ! En
décalage, et même en contradiction. Cette prise de conscience fut infiniment
lente et longue. Lorsque cet état des choses fut enfin défini, mes racines
étaient déjà solidement implantées dans leur sol. Indéracinables. Mon ami, en cherchant une réponse à ta question de quatre
mots, je me suis spontanément retrouvée au milieu de ma vie. J’avais trente-cinq
ans et je vivais le moment le plus difficile de mon existence. Le plus triste
aussi, dont les traces ne se sont jamais totalement effacées. Cet épisode, je l’avais consigné, jour après jour, dans des
petits carnets auxquels je me confiais. Je ne les ai pas souvent relus :
ils ont toujours eu le pouvoir de me bouleverser, de me mettre l’âme à
l’envers, de creuser au fond de moi un abîme d’émotions, comme si les années
n’avaient pas passé, comme si j’étais encore aussi vulnérable qu’en ce
lointain moment, lorsqu'ils me tenaient lieu de confidents.
1 J’avais trente-cinq ans. J’étais sur un paquebot faisant route
vers Marseille. Pas la route normale par le canal de Suez. Celui-ci était
fermé à la navigation depuis quelques mois, suite à la guerre des Six-Jours.
De l’océan Indien, les routes maritimes vers l’Europe devaient alors
contourner le cap de Bonne Espérance, comme au temps des galions de la flotte
portugaise. Avec mon mari Gilles, nous partions, par cette voie très
lente, vers l’Europe pour de longues semaines. Ce n’était pas encore la mode
des croisières. C’était encore le temps des lignes maritimes assurant le
transport de passagers qui pouvaient se permettre de prendre du temps pour
arriver à destination. Ces déplacements lents étaient par eux-mêmes des
sortes de vacances, le trajet étant jalonné par des ports à visiter. Sur un
bateau, on vit comme en parenthèse du monde et surtout de sa propre vie. Nous
avions donc devant nous trente-cinq jours tout à fait atypiques. Si j’étais contente de me trouver en vacances, j’étais en même
temps et depuis quelque temps déjà, habitée par un malaise intermittent dont
je ne pouvais définir la cause. Mais il refaisait surface, inlassablement. Ce
malaise avait été provisoirement occulté pendant la période d’organisation de ce voyage dans laquelle j’avais dû
m’investir à plein temps. Il y avait eu tant de choses à prévoir, aussi bien
pour la vie familiale que pour la vie professionnelle ! Les longs départs impliquent une longue séparation. Ils
partagent nécessairement. On est heureux et malheureux à la fois. On laisse
toujours derrière soi quelque chose, des personnes auxquelles on tient.
C’était le moment que je n’aimais vraiment pas. Je m’étais durcie, bardée,
pour dire au revoir à nos deux enfants qui nous avaient accompagnés
au bateau avec une partie de la famille. Je ne voulais pas, vu la chance que j’avais de m’évader vers
d’autres horizons, me laisser aller en m’attendrissant trop, en pensant au
côté triste du départ, ce qui me mettrait l’âme à l’envers. Je ne voulais surtout
pas que la carapace derrière laquelle je me protégeais confortablement,
vieille habitude bien solide, arrive à craquer, là, en public. Précédé par le bateau-pilote qui servait d’éclaireur, le
navire avait largué ses amarres et commençait à glisser tout doucement vers
la sortie du port. Sur le talus du jardin au bord de l’eau, agitant des
mouchoirs, était rassemblée notre famille. Ces mouchoirs agités, c’était un
peu ridicule, mais en même temps triste. Ma gorge était serrée en voyant
s’amenuiser les silhouettes de ceux que j’aimais et que je laissais quand
même. Mon amie de toujours, Colette, nous accompagnait jusqu’à Durban. Sa compagnie m’avait toujours été vraiment bénéfique. J’en étais donc très heureuse. Gilles, mon mari, affichait, lui, à ce moment, ce visage particulier qu’il ne porte qu’en vacances et que je ne pouvais m’empêcher de trouver niais... Au lieu de m’en réjouir, je m’étais sentie agacée.
2 La vie à bord d’un paquebot rassemble tout un groupe de
personnes que le hasard réunit et qui n’auront pas d’autres possibilités que
de vivre ensemble pendant plusieurs semaines ; vivre ensemble en
désœuvrés, après avoir pour la plupart coupé les amarres, au propre comme au
figuré, avec leurs vies normales. Pour l’instant nous étions circonscrits en
vase clos et chacun allait avoir à faire le choix de remplir son temps comme
il le pourrait ou qu’il le voudrait. Mais toujours conditionné par cet espace
fermé. Ce n’était pas encore l’ère de la communication telle que nous
la vivons maintenant. Intelsat, le premier réseau commercial de communication
internationale par satellite géostationnaire, venait tout juste d’être mis en
orbite. Encore très onéreux, il fallait être équipé pour pouvoir l’utiliser. Il est difficile actuellement d’imaginer qu’il nous fallait
attendre d’arriver à un port pour apprendre, par lettres écrites depuis
parfois plusieurs semaines, qui avaient voyagé dans des sacs postaux,
transitant à toutes sortes de points sur la Terre, les nouvelles de ceux
restés derrière soi. Circulant sur les océans, on était vraiment coupé du
monde et de son monde. C’était dans ce vase clos, délestée de mon travail, de mes
responsabilités familiales, dans cet environnement social éphémère, que
j’allais me retrouver sans un seul lieu de solitude, sauf la cabine que je
partageais évidemment avec un mari dont la présence était arrivée à m’irriter
souvent. Si je savais que la vie à bord allait être une vie futile,
reposante en somme, où ne compteraient que les amusements, les bons repas, le
plaisir de bien s’habiller, l’attente curieuse des escales, je ne m’attendais
vraiment pas à y ressentir ce besoin devenu impératif d’auto-analyse. Ce
besoin de comprendre où j’en étais. Je fus la première à en être surprise. Je ne savais même pas
comment m’y prendre. Ni quand, ni où, dans ce contexte de vie à bord, très
superficiel. Il y avait en moi comme un flou. Je me sentais un peu
spectatrice de moi-même. Et je me disais qu’il n’y avait cependant pas d’urgence, que
laisser les choses se préciser d’elles-mêmes était sans doute ce que je
pouvais faire de mieux. Je ressentais une vraie réticence à pénétrer dans ce
malaise pour en chercher les raisons. Je me trouvais des prétextes pour
renvoyer cette démarche que je pressentais dérangeante. Habitée par une vraie
crainte, je m’accrochais à ce recours à la facilité. |